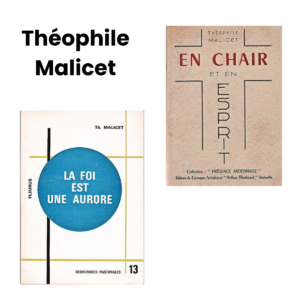Né à Nouzonville dans les Ardennes en 1897 et mort dans ce même département, à Charleville-Mézières en 1976, Théophile Malicet aurait pu sans problème figurer dans le dossier du numéro 41 de Livr’Arbitres consacré à la littérature prolétarienne.
Fils d’un forgeron franc-maçon, libre-penseur et républicain, et ami de Jean-Baptiste Clément, l’auteur, entre autres chansons, du Temps des Cerises, il est le huitième enfant d’une fratrie de neuf.
Ni Dieu, ni maître
Théophile Malicet baigne très tôt dans une ambiance politique et militante. La « fabrique » de son père, que Théophile surnomme le « Paterfamilias », est le lieu de passage et de rendez-vous de toutes les tendances de la gauche révolutionnaire de l’époque dans les Ardennes. Outre, Clément, on y croise des syndicalistes, des membres du Parti socialiste ouvrier révolutionnaire (PSOR) comme le futur député du coin Albert Poulain, des anarchistes (François, un des oncles de Théophile milite au sein du Groupe Les Déshérités), des communistes libertaires comme Jean-Charles Fortuné Henry fondateur et animateur de la communauté socialiste utopique L’Essai, à Aiglemont.
Les damnés de la terre
Ouvrier à 11 ans, Théophile travaille à son tour à la forge, comme le père, comme ses frères.
« Demain, tu prends la deuxième forge, m’a annoncé un soir Paterfamilias. T’as l’âge maintenant, on va te voir à l’œuvre. Et je forge ; ce qui n’est pas petite affaire. Ma main droite commande au vent ; ma gauche serre la tenaille. » Maintenant je suis en bleu, comme tous mes frères. Je suis ouvrier ; et il va falloir en découdre !
Il va se faire le témoin assidu de ce qui l’entoure, de cette vie ouvrière pauvre et digne dans ce secteur baptisé parfois les Ardennes rouges.
Il brossera le tableau sa condition miséreuse, bien plus tard, dans Debout, frères de misère, évoquant « les talentueux rafistolages de mes sabots-bottes, ou devant les bâillements d’oiseaux goulus des bottines de ma petite sœur. Nous mangeons à notre faim, certes, de fantastiques assiettées de légumes, que maman ramène du jardin, de gros « cugnons » de pain rassis, agrémentés d’un sucre qu’on pourlèche, qu’on suçote, qu’on ménage, en se disant à part soi : c’est aussi bon que le chocolat ! Affaire de suggestion ! » avant d’ajouter « On se suggestionne énormément quand on est pauvre. Le grand jeu c’est de simuler l’espérance. »
A l’opposé de son père, athée militant, le jeune Théophile se montre très tôt attiré par une certaine spiritualité, dont l’élément déclencheur est certainement le décès prématuré de sa petite sœur.
« (…) La revoir ! Savoir comment elle est, dans sa boîte, sous la terre… Sûrement qu’elle m’entendrait, et me répondrait, si on me laissait lui parler, lui dire les mots de ma collection ! (…) Certes Jules m’a affirmé à plusieurs reprises que notre sœur est maintenant un ange au Ciel. Un ange ! Si c’était vrai, tout de même. Comme ce doit être bon et doux d’avoir une sœur enrôlée chez les anges ! Avant de m’endormir, dans un halo fait d’une lumière qui n’était plus celle de la lampe, je m’efforce de la voir vêtue de bleu fort tendre, cheveux défaits, sans bas, avec des ailes.
(…) Sa tombe est arrangée ; papa lui a porté son chef-d’œuvre en fer tortillé, le plus beau de tout le cimetière ; et toutes les fleurs du Hochet (le cimetière) sont pour elle ; mais je l’ai remarqué, elle n’a pas de croix, ma sœur, et c’est encore plus triste qu’une autre tombe, une tombe sans croix. »
Jules, le frère aîné, se convertira d’ailleurs au catholicisme, peu de temps avant la guerre de 14, acte de foi qui entrainera une crise sans précédent au sein de la famille.
En 1914, trois de ses frères, plus âgés, sont mobilisés. Deux d’entre eux, dont Jules, adoré de Théophile, ne reviendront pas du Front. « Par le train du matin, mon Jules partait, premier appelé au rendez-vous avec la mort »… Le troisième rentrera aveugle.
Le Paterfamilias, quoiqu’âgé de 64 ans, s’engage par patriotisme dans un élan d’Union sacrée qui balaie, pour un temps, la lutte de classe d’antan. Il en reviendra brisé, « pire que mort, usé, fini, paralysé » et mourra peu de temps après avoir vendu sa fabrique qui ne valait d’ailleurs plus grand chose. Quand à Théophile, il est réquisitionné par les Allemands, puisque les Ardennes sont occupées, alternant travaux forcés et camp disciplinaire jusqu’en 1918. Il laissera un récit de ces épreuves, Prisonniers civils, paru en 1937.
L’étude est une lutte
Contraint d’arrêter l’école à 11 ans, Théophile s’est presqu’immédiatement replongé avec rage dans l’étude. Une rage toute révolutionnaire. « Et tout cela, ma boulimie d’étude, l’espoir insensé qui m’empoigne, me font pleurer l’école, et sournoisement me révolter contre le sort. Au travers des carreaux enfumés de la boutique, je les regarde partir vers leurs classes, ils continuent d’étudier, ils seront savants, ces gosses de riches ou fils uniques qui, jadis, ne m’ont jamais admiré que par derrière. J’en appelle à votre souvenir, mon vieux maître, mon vénéré Monsieur Cochart ! C’est vrai, n’est-ce pas ce que je dis là ? Tout le bonheur pour eux seuls, ce serait abominable. Ce ne sera pas. J’apprends comme eux, et je saurai plus, quand je devrais m’user les yeux et ne plus dormir ».
Dans le courant des années 30, il découvre Henri Poulaille et le mouvement de la littérature prolétarienne qui est pour lui une révélation. On peut ainsi être ouvrier, autodidacte, écrire sur la vie des siens, tout en étant publié, et lu !
Converti à son tour au catholicisme, il est infirmier pour la Croix rouge durant la Seconde Guerre mondiale. Adepte du mouvement social chrétien, militant CFTC, il animera les instances régionales du syndicat chrétien jusqu’en 1956. Il racontera son itinéraire spirituel, très critique à l’égard des institutions ecclésiastiques, dans son ouvrage La foi est une aurore, paru en 1964.
Cet écrivain modeste et discret, Prix de poésie populiste en 1948, dont le souvenir demeure malheureusement cantonné à son département natal, a été le peintre ainsi que le conteur fidèle et privilégié d’un milieu prolétaire disparu.
Article paru dans le numéro 44 de la revue Livr’Arbitre