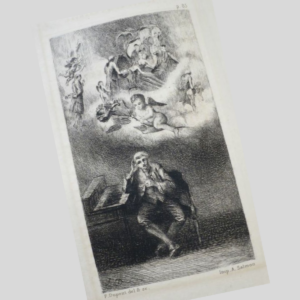Avec le Confinement, les éditeurs ont vu affluer sur leur table de lecture, une profusion de récits, romans, essais et écrits de tous types nés de l’inaction imposée à une large majorité de la population. Si cette récente « littérature de confinement » ne semble avoir accouché d’aucun chef-d’œuvre notable, elle n’est cependant pas la fille unique de la panique covidienne de l’année 2020. Dès 1794 en effet, Xavier de Maistre en jetait les bases avec son audacieux « Voyage autour de ma chambre ».
Né en 1763 à Chambéry, ville qui appartient alors au royaume de Sardaigne sous la suzeraineté de la Maison de Savoie, Xavier de Maistre est un jeune noble, douzième d’une famille de quinze enfants. Sa mère étant décédée l’année de ses 10 ans, c’est son frère aîné, Joseph, le futur homme politique, philosophe et écrivain, qui lui sert de parrain.
Du rêveur né…
Dès son enfance, Xavier se fait remarquer par sa propension à la rêverie, notamment durant ses heures d’études. Cela lui vaut le surnom durable, qu’il utilise lui-même, de « Bans », dérivé du patois savoyard « baban », qui signifie étourneau. Toute sa vie, il paraphera d’ailleurs de la sorte certaines de ses lettres, ainsi que la plupart de ses tableaux, utilisant parfois la variante « X-B » pour « Xavier-Bans ». Ayant rejoint l’armée russe en 1799, il ne craindra pas de continuer à signer certaines missives avec un surprenant « Bans, capitaine piémontais, servant à l’avant-garde russe ».
…au cadet de Savoie
Car Xavier de Maistre n’est pas simplement le doux rêveur que son surnom laisse deviner. Dès 1781, âgé de 18 ans à peine, il s’engage dans le corps d’infanterie de marine de l’armée sarde. En 1784, il participe à une ascension en montgolfière, la huitième seulement réalisée à l’époque. Le document de lancement de l’aventure, intitulé Prospectus de l’expérience aérostatique de Chambéry, publié au nom des premiers souscripteurs, aurait été conjointement rédigé par les deux frères, Joseph et Xavier.
Devenu lieutenant en 1790, il combat contre les troupes françaises lors de l’invasion du territoire savoyard en 1792. L’année suivante le trouve à Aoste où son régiment prend ses quartiers d’hiver après de sévères combats dans les Alpes. Il y restera finalement plus de 5 ans, jusqu’en 1799.
Entre la monotonie de la servitude militaire, l’approfondissement de ses connaissances littéraires, le dessin et la peinture, il trouve le temps de tomber amoureux – mais le temps manque rarement pour cela – d’une jeune veuve, Marie-Delphine Pétey. En fait, ce séjour valdotain va incontestablement être marqué par ce qui restera le chef d’œuvre de Xavier de Maistre.
En 1794, en effet, le jeune homme est impliqué dans un duel, et ce n’est pas son premier, contre l’un de ses confrères. Or, si le roi de Sardaigne tolère que ses officiers se fassent trucider par l’ennemi, il accepte assez mal qu’ils se livrent entre eux à ce petit jeu.
Heureux qui, comme Ulysse…
Condamné aux arrêts, pendant 42 jours, dans sa chambre de la forteresse de Turin, Xavier de Maistre va alors se livrer à un brillant jeu d’écriture et d’introspection qui, aujourd’hui encore, fait le délice des lecteurs et amateurs du genre parodique. Son récit, de quelques dizaines de pages à peine est découpé en 42 très courts chapitres, un par journée de relégation.
« Je suis persuadé, note t-il à ce propos, qu’on voudrait savoir pourquoi mon voyage autour de ma chambre a duré quarante-deux jours au lieu de quarante-trois, ou de tout autre espace de temps ; mais comment l’apprendrais-je au lecteur, puisque je l’ignore moi-même ? Tout ce que je puis assurer, c’est que, si l’ouvrage est trop long à son gré, il n’a pas dépendu de moi de le rendre plus court ; toute vanité de voyageur à part, je me serais contenté d’un chapitre ».
Ainsi, le jeune officier se mue en un observateur attentif à tout ce qui l’entoure, meubles et objets. Redevenu le rêveur de son enfance, il écrit « j’avoue que j’aime à jouir de ces doux instants, et que je prolonge toujours, autant qu’il est possible, le plaisir que je trouve à méditer dans la douce chaleur de mon lit » avant d’ajouter, en connaisseur, « pour me procurer ce plaisir mon domestique a reçu l’ordre d’entrer dans ma chambre une demi-heure avant celle où j’ai résolu de me lever. Je l’entends marcher légèrement et tripoter dans ma chambre avec discrétion, et ce bruit me donne l’agrément de me sentir sommeiller : plaisir délicat et inconnu de bien des gens.
On est assez éveillé pour s’apercevoir qu’on ne l’est pas tout à fait et pour calculer confusément que l’heure des affaires et des ennuis est encore dans le sablier du temps ».
Livrant un récit ironique et léger, parodiant avec subtilité les récits des grands voyageurs de l’époque, il dialogue avec lui-même, ce repos forcé étant l’occasion d’une introspection très pince-sans-rire qui, en cette année 1794, semble bien éloignée de la fureur révolutionnaire qui se déchaine en Europe.
« Que tous les malheureux, les malades et les ennuyés de l’univers me suivent ! – Que tous les paresseux se lèvent en masse ! Et vous qui roulez dans votre esprit des projets sinistres de réforme ou de retraite pour quelque infidélité ; vous qui, dans un boudoir, renoncez au monde pour la vie ; aimables anachorètes d’une soirée, venez aussi : quittez, croyez-moi, ces noires idées ; vous perdez un instant pour le plaisir sans en gagner un pour la sagesse : daignez m’accompagner dans mon voyage ; nous marcherons à petites journées, en riant, le long du chemin, des voyageurs qui ont vu Rome et Paris ; – aucun obstacle ne pourra nous arrêter ; et, nous livrant gaiement à notre imagination, nous la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire. »
Très représentatif de l’aristocratie cultivée de l’époque, Xavier de Maistre émaille ses observations de nombreuses considérations, littéraires, musicales, historiques et philosophiques. Retourné à ses occupations militaires, il confie ce manuscrit à son frère aîné, Joseph.
« Mon frère et moi, nous étions comme les deux aiguilles d’une montre : il était la grande, j’étais la petite ; mais nous marquions la même heure, quoi qu’une manière différente. »
Séduit, le célèbre contre-révolutionnaire, futur auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg, fera publier le texte dès l’année suivante, de son propre chef et à l’insu de son auteur, sous le titre de Voyage autour de ma chambre.
La retraite de Russie
Après le licenciement de l’armée par le roi Charles-Emmanuel IV en 1798, Xavier se retrouve un temps officier sans solde, avant de se mettre au service du tsar Paul Ier. Sa carrière militaire sera dès lors indissociable du sort des armées russes dont il deviendra un général en 1813, après la désastreuse campagne de Russie de Napoléon. Cette même année, il se marie à une princesse russe, demoiselle d’honneur à la Cour impériale et tante de l’épouse de Pouchkine. D’abord logé pendant plusieurs années au sein même du Palais d’Hiver, le couple s’installe à Florence, en Italie, de 1826 à 1838. Il se fixe définitivement ensuite à Saint-Pétersbourg, le long de la Moïka. Il s’y consacre à la peinture et à une invention nouvelle, le daguerréotype, ancêtre de la photographie. Il meurt en 1852.
Il a laissé quelques autres écrits, dont une Expédition nocturne autour de ma chambre, publiée en 1825, mais qui n’égale pas l’original.
Aujourd’hui délaissé et injustement passé de mode, son Voyage a pourtant connu un grand succès avec pas moins de 200 éditions en un peu plus d’une centaine d’années, suscitant l’admiration d’auteurs aussi différents que Lamartine (« C’est un génie familier, un causeur du coin du feu, un grillon du foyer champêtre »), Anatole France, Henry Bordeaux ou Somerset Maugham.
Lire ou relire Xavier de Maistre, est assurément un acte de résistance dans un monde qui va trop vite, sans but et sans boussole.
« Aussi, lorsque je voyage dans ma chambre, je parcours rarement une ligne droite : je vais de ma table vers un tableau qui est placé dans un coin ; de là je pars obliquement pour aller à la porte ; mais, quoique en partant mon intention soit bien de m’y rendre, si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façons, et je m’y arrange tout de suite. — C’est un excellent meuble qu’un fauteuil ; il est surtout de la dernière utilité pour tout homme méditatif. Dans les longues soirées d’hiver, il est quelquefois doux et toujours prudent de s’y étendre mollement, loin du fracas des assemblées nombreuses. — Un bon feu, des livres, des plumes, que de ressources contre l’ennui ! Et quel plaisir encore d’oublier ses livres et ses plumes pour tisonner son feu, en se livrant à quelque douce méditation, ou en arrangeant quelques rimes pour égayer ses amis ! Les heures glissent alors sur vous, et tombent en silence dans l’éternité, sans vous faire sentir leur triste passage. »
paru dans Livr’Arbitre n° 46